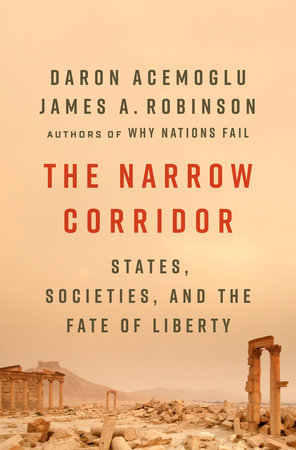
« (…) Le message clé du nouveau livre de Daron Acemoglu et James Robinson, The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, (…) est que les perspectives de liberté et de prospérité tiennent sur un fil du rasoir entre, d’une part, l’oppression étatique et, d’autre part, l’anarchie et la violence qu’une société s’inflige si souvent. Donnez trop de poids à l’Etat par rapport à la société et vous vous retrouvez avec le despotisme. Affaiblissez l’Etat vis-à-vis de la société et vous obtenez l’anarchie.
Comme le signale le titre du livre, il n’y a qu’un "corridor étroit" entre ces deux dystopies, un mince sentier que seuls quelques pays, principalement situés dans l’Occident industrialisé, ont réussi à trouver. De plus, ce n’est pas parce qu’un pays parvient à atteindre ce sentier qu’il faut s’attendre à ce qu’il y reste. Acemoglu et Robinson soulignent qu’une régression autoritaire reste toujours une possibilité, à moins que la société civile reste vigilante et s’avère capable de mobiliser contre les potentiels autocrates.
Le nouveau livre d’Acemoglu et Robinson poursuit la réflexion qu’ils menèrent dans leur précédent blockbuster, Why Nations Fail. Dans cet ouvrage et dans d’autres écrits, ils identifiaient ce qu’ils qualifiaient d’"institutions inclusives" comme le principal facteur derrière le progrès économique et politique. Ces institutions, telles que les droits de propriété sécurisés et l’Etat de droit, ont pour caractéristique d’être accessibles à tous les citoyens (ou presque) et de ne pas avantager une minorité étroite d’élites au détriment du reste de la société.
Un pays qui a donné du fil à retordre à la thèse d’Acemoglu-Robinson est la Chine. La monopolisation du pouvoir politique par le parti communiste chinois, la corruption rampante du pays et la facilité avec laquelle les concurrents économiques et les opposants politiques du parti peuvent être dépouillés ne donnent pas l’image d’institutions inclusives. Pourtant, il est indéniable qu’au cours des quatre dernières décennies, le régime chinois a permis des taux de croissance économique sans précédents et la réduction de la pauvreté la plus impressionnante que l’humanité ait connue.
Dans Why Nations Fail, Acemoglu et Robinson affirmaient que la croissance économique chinoise s’épuiserait à moins que les institutions politiques extractives laissent la place à des institutions inclusives. Ils n’abandonnent pas cette thèse dans The Narrow Corridor. Ils estiment que la Chine est un pays où un Etat fort a dominé la société pendant plus de deux millénaires. Selon eux, parce que la Chine a passé autant de temps hors du corridor, il est improbable qu’elle puisse rejoindre facilement ce dernier. Ni la réforme politique, ni la poursuite de la croissance économique ne semblent probables.
Il y a un autre grand pays qui semble maintenant poser problème à la thèse originelle d’Acemoglu-Robinson : ce sont les Etats-Unis. A l’époque où Why Nations Fail a été écrit, beaucoup considéraient encore les Etats-Unis comme un exemple d’institutions inclusives : un pays qui s’est enrichi et est devenu démocratique via le développement des droits de propriété sécurisés et l’Etat de droit. Aujourd’hui, la répartition des revenus des Etats-Unis s’apparente à celle d’une ploutocratie. Et les institutions politiques représentatives du pays, sous les coups d’un démagogue, semblent manifestement friables.
The Narrow Corridor semble avoir été écrit en partie pour expliquer l’apparente fragilité des démocraties libérales. Les auteurs parlent d’"effet de Reine Rouge" (Red Queen effect) pour évoquer la lutte incessante pour préserver l’ouverture des institutions politiques. Comme le personnage du livre de Lewis Carroll, la société civile doit courir toujours plus vite pour repousser les dirigeants autoritaires et refreiner leurs tendances despotiques.
La capacité de la société civile à tenir face au "Léviathan" dépend quant à elle des divisions sociales et de leur évolution. La démocratie émerge typiquement soit de l’essor de groupes populaires qui peuvent remettre en cause le pouvoir des élites, soit des divisions entre les élites. Au cours des dix-neuvième et vingtième siècles, l’industrialisation, les guerres mondiales et la décolonisation ont été liés à la mobilisation de tels groupes. Les élites au pouvoir ont accédé aux demandes des opposants : que le droit de vote soit étendu, sans exigences en matière de propriété, (généralement) à tous les hommes. En retour, les groupes nouvellement affranchis acceptaient de se voir imposer des limites à leur capacité d’exproprier les propriétaires. Bref, les droits de vote ont été échangés contre des droits de propriété.
Mais comme je le discute dans un travail que je réalise avec Sharun Mukand, la démocratie libérale a besoin de plus : des droits qui protègent les minorités (ce que nous pouvons appeler des droits civiques). La caractéristique distinctive du cadre politique qui génère la démocratie est qu’il exclut le principal bénéficiaire des droits civiques (les minorités) de la table des négociations. Ces minorités ont ni les ressources (contrairement à l’élite), ni le nombre (contrairement à la majorité) avec eux. Le cadre politique favorise donc un genre appauvri de démocratie (ce que l’on peut appeler la démocratie électorale) par rapport à la démocratie libérale.
Cela contribue à expliquer pourquoi la démocratie libérale est un spécimen rare. L’échec à protéger les droits des minorités est une conséquence facilement compréhensible de la logique politique derrière l’émergence de la démocratie. Ce qui appelle une explication, ce n’est pas la rareté relative de la démocratie libérale, mais son existence. La surprise n’est pas qu’il y ait si peu de démocraties libérales, mais pourquoi il y en a tout court.
Ce n’est pas vraiment une conclusion réconfortante à une époque où la démocratie libérale semble très menacée, même dans ces parties du monde où elle semblait avoir été en permanence bien établie. Mais en prenant conscience de la fragilité de la démocratie libérale, nous pouvons peut-être éviter la lassitude qui nous afflige lorsqu’on la considère comme garantie. »
Dani Rodrik, « Democracy on a knife-edge », 9 octobre 2019. Traduit par Martin Anota
Tag - James Robinson
mardi 5 novembre 2019
La démocratie sur le fil du rasoir
Par Martin Anota le mardi 5 novembre 2019, 11:00 - Politique
mercredi 26 mars 2014
Le capital social et l'ascension d'Hitler
Par Martin Anota le mercredi 26 mars 2014, 16:00

« Lorsque nous avons repris les travaux de David Laitin pour expliquer pourquoi le nationalisme basque est devenu violent, mais pas le nationalisme catalan, nous avons souligné que cela s'expliquait en partie parce que le pays basque possède le type de capital social "horizontal" ou "liant" (bonding) qui, selon Robert Putnam et ses collaborateurs dans leur célèbre ouvrage Making Democracy Work, aurait joué un rôle crucial pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance.
Dans l’étude que nous avons réalisée avec Tristan Reed sur la politique de la chefferie suprême en Sierra Leone et dont nous avons parlé l'année dernière, nous avons trouvé un grand nombre de faits empiriques qui nous ont amenés à être sceptiques à ce sujet. En Sierra Leone, les données empiriques suggèrent que peu importe comment vous mesurez le capital social, il est négativement corrélé avec les institutions politiques locales moins responsables et le développement économique.
Un autre puissant exemple des inconvénients du capital social est fourni par la récente étude "Bowling for fascism: Social capital and the rise of the Nazi party in Weimar Germany, 1919-33" réalisée par Shanker Satyanath, Nico Voigtländer et Hans- Joakim Voth. Les auteurs ont recueilli des données sur la mesure du capital social en Allemagne dans les années vingt, tel qu’il est mesuré par la "densité de la vie associative", c’est-à-dire la présence de différents groupes sociaux tels que les clubs sportifs, les chorales, les associations d'élevage d'animaux ou les clubs de gymnastique Leur mesure du capital social dans une ville correspond au nombre total de ces associations pour 1000 habitants. Ils montrent que le parti nazi s’est développé le plus rapidement en termes d'adhésion et il a également enregistré le plus de votes totaux là où le capital social est le plus important. L'histoire montre que, comme l'ETA au Pays basque, le parti nazi était très habile pour exploiter les possibilités offertes par le capital social pour recruter de nouveaux membres.
Une conclusion à tirer de tout ce travail n'est pas que Putnam avait tort. En effet, ses arguments sont plausibles en ce qui concerne l'Italie et les analyses empiriques ont en tendance à les soutenir (c’est par exemple le cas de l’étude "Long-term persistence" réalisée par Luigi Guiso, Paola Sapienza et Zingales Luigi). Plutôt, la bonne conclusion serait que l'impact du capital social est très hétérogène et dépend fondamentalement de la façon par laquelle il interagit avec d'autres aspects des institutions et politiques d'une société. Satyanath, Voightlander et Voth retrouvent un peu de cette idée, car ils montrent qu’en Prusse, un pays qui avait des institutions plus fortes, la relation entre le capital social et la montée du parti nazi était beaucoup plus faible. Ils en concluent que leurs "résultats suggèrent que des institutions fortes et inclusives peuvent garder le côté sombre du capital social sous contrôle".
C’est agréable à entendre, même si évidemment ce n'est pas seulement des institutions inclusives qui ont permis de garder sous contrôle le côté sombre du capital social, puisque l'État prussien des années vingt qui a contrôlé ce type de capital social était loin d'être inclusif. De toute évidence, le mystère du capital social n’est pas résolu. »
Daron Acemoglu et James Robinson, « The benefits of social capital? Bowling for Hitler », in Why Nations Fail (blog), 11 mars 2014. Traduit par Martin Anota
vendredi 14 mars 2014
Pourquoi le Pays basque est-il plus violent que la Catalogne ?
Par Martin Anota le vendredi 14 mars 2014, 19:05
« Dans notre précédent billet, nous avons examiné pourquoi les Catalans en Espagne avaient développé une identité catalane distincte, au point d’exiger un Etat indépendant, alors que ce n’est pas le cas des Catalans français. En regardant plus largement la scène espagnole, on voit l'échec dans la création d’une identité espagnole plus largement. Cela est vrai non seulement en Catalogne, mais aussi en Galice et encore plus évidemment au Pays basque.
Mais cette observation soulève d'autres questions intéressantes, car il y a évidemment une énorme différence entre le nationalisme de la Catalogne et celui du Pays basque : le premier n'est pas violent tandis que le second l’est. Comment peut-on expliquer ça ?
Exactement ce sujet a été abordé par le politologue David Laitin dans son article "National revivals and violence". Laitin a affirmé qu’au Pays basque, le mouvement nationaliste ETA a très bien réussi à puiser dans le capital social local et à recruter de jeunes hommes dans les petites villes, au sein des clubs d’escalade, appelés mendigoitzale, ou des gangs de jeunes, appelés cuadrillas. En revanche la Catalogne manquait de ce type de groupes sociaux et de capital social. (C’est lié à l'idée que le capital social peut être utilisé à des fins bonnes ou mauvais, de sorte que ses implications politiques sont beaucoup plus subtiles que ce que l'on pourrait penser à première vue, comme nous l’avons vu dans un billet il y a longtemps).
Laitin affirme que, au Pays basque, la vie dans les petites villes a été dominée par les liens clientélistes avec les partis politiques et que les groupes économiques, comme les syndicats, furent beaucoup plus importants. Cela a fourni une base sociale aux partis politiques et ces derniers furent beaucoup plus enclins à négocier qu’à se battre.
Laitin affirme aussi que ces différentes structures sociales ne font que faciliter le recrutement daau Pays basque et elles font aussi davantage pencher vers l’action violente puisque l'ETA, basée sur le capital social local, n'a pas disposé de canaux simples et efficaces pour communiquer avec Madrid, chose qui aurait pourtant facilité les négociations (contrairement à la situation en Catalogne).
Paradoxalement, ce qui a provoqué la violence était qu'il était "plus coûteux" pour les habitants du Pays basque de devenir nationalistes basques, notamment d'un point de vue linguistique. Le basque est une langue non indoeuropéenne et radicalement différente de l'espagnol, tandis que le catalan en est très proche. Ainsi, dans le cas basque, il était plus difficile d’"encourager" les populations locales à se tourner vers le nationalisme sans utiliser la violence. En Catalogne, il était beaucoup plus facile de parler le catalan, et les gens se sont probablement attendu à ce que les autres perlent catalan, quelque chose qui était beaucoup moins probable avec le basque.
Laitin utilise cet exemple de la langue un peu comme une métaphore pour montrer qu’il était plus difficile d’être Basque que d'être Catalan, ce qui se traduisit par le fait que ceux qui essaient de promouvoir le nationalisme basque étaient plus enclins à recourir à la violence.
Le dernier morceau dans l’argumentation de Laitin est plus idiosyncrasique. Il affirme que les premiers succès se sont révélés importants dans le maintien d’une stratégie violente pour l'ETA. Les commandos de l'ETA ont assassiné Luis Carrero Blanco, le Premier ministre espagnol et héritier présomptif de Franco, et les adhésions à l'ETA se sont alors immédiatement multipliées. L'exécution de deux prisonniers de l'ETA en 1975 a entraîné une grève générale qui a transformé les victimes en martyrs et a renforcé le soutien à l'ETA.
Au final, l'analyse de Laitin prend en compte des facteurs structurels, la nature différente du capital social, le coût différent d'être Basque, avec des chocs idiosyncrasiques qui ont permis à des stratégies violentes de se consolider et de réussir. »
Daron Acemoglu et James Robinsons, « Why is the Basque Country more Violent than Catalunya? », in Why Nations Fail (blog), Traduit par Martin Anota.
dimanche 9 mars 2014
Quel est le problème avec la Catalogne espagnole ?
Par Martin Anota le dimanche 9 mars 2014, 16:33 - Politique

« La plupart des études rélisées par les économistes sur l’Etat ont mis l'accent sur un sous-ensemble très étroit d’actions étatiques. Par exemple, l'article de Daron “Politics and economics in weak and strong States” considère que la capacité de l’Etat à accroître la pression fiscale est la principale chose qui détermine s’il est faible ou fort. Ce fut par conséquent un thème clé dans le livre Pillars of Prosperity de Tim Besley et Torsten Persson publié en 2011 où ils se sont concentrés sur le développement des systèmes fiscaux pour prélever les impôts et sur les institutions juridiques mises en place pour faire respecter efficacement les contrats. Dans notre travail avec Rafael Santos sur la Colombie, “Monopoly of violence: Evidence from Columbia”, nous nous sommes penchés sur la création d'un monopole de la violence. (Nous allons aussi bientôt présenter une autre de nos études qui porte sur les conséquences économiques de la capacité et la construction de l'Etat).
Mais toutes ces études ignorent l'une des choses les plus fondamentales que les Etats modernes font : créer une identité nationale en éliminant d'autres identités. Par exemple, l’une des raisons pour laquelle la Tunisie moderne est si différente de la Libye voisine est que, le premier président après l'indépendance, Habib Bourguiba, a investi massivement dans la création d'une identité nationale. Par contre, les dirigeants de la Libye, comme Mouammar Kadhafi, ont exploité et exacerbé les différentes identités pour rester au pouvoir.
Les Etats modernes diffèrent évidemment beaucoup dans la façon par laquelle ils réussissent à créer des identités nationales et cela a d'énormes répercussions, comme le montre l'exemple précédent (c’est la Libye, et non la Tunisie, qui est au bord de la guerre civile pour le moment). Cela est également vrai en Europe, alors que l’on a tendance à croire que les pays européens sont dotés d’États-nations particulièrement robustes. Prenons le cas de l'Espagne et de la France. Bien que certaines personnes dans le sud-ouest de la France parlent encore l’occitan et se plaignent de l’influence de Paris, le fait est que l'Etat français a fait un travail très efficace pour forger une identité nationale (l’ouvrage clé sur ce processus est le livre Peasants into Frenchmen écrit par Eugen Weber de 1976 dont nous avons parlé dans un précédent billet où nous avons expliqué pourquoi les Anglais avaient été si mauvais pour effacer l'identité des Ecossais ; ces derniers pourraient par ailleurs le leur rendre sans gratitude en déclarant leur indépendance cette année).
Dans une récente étude, Laia Balcells, professeur de sciences politiques à l'Université Duke, a étudié les différences entre les Catalans au sud de la frontière espagnole et ceux au nord. Dans son article "Mass schooling and Catalan nationalism", elle rappelle que la Catalogne a été divisée entre la France et l'Espagne par un traité en 1659. Les Catalans ont eu une histoire distincte avec leur propre langue, pourtant l’intensité avec laquelle les gens s'identifient comme Catalans aujourd'hui diffère grandement au nord et au sud de la frontière. En Catalogne espagnole, Balcells montre que le catalan est la principale langue de communication entre membres de la famille pour 37 % de la population (…). En Catalogne française, en revanche, seulement 0,5 % de la population parle le catalan en famille : le français est la langue principale de communications entre membres de la famille pour 87,6 % de la population. Cette utilisation différenciée de la langue dénote des différences d'identité.
La question est donc la suivante : pourquoi y a-t-il eu une telle divergence entre les Catalans espagnols et les Catalans français ? Pourquoi les premiers exigent aujourd’hui un référendum pour devenir un pays indépendant alors qu’il n’y a rien de la sorte en France ?
À un certain niveau, une partie de la réponse réside évidemment dans ce qu’Eugene Weber a écrit sur le sujet. Les Français ont créé un Etat descendant (top down) très efficace qui a permis de socialiser tout le monde pour en faire des Français, en particulier à travers un système éducatif où le français était la seule langue qui pouvait être utilisée.
Balcells ne conteste pas cette affirmation, mais fait une réponse plus subtile. Elle le fait dans un contexte de "réveils nationalistes" (nationalistic revivals) qui se déroulent en trois phrases : la phase A qu'elle appelle "l'intérêt des chercheurs" (scholarly interest) et qui est impulsée par des intellectuels qui découvrent et célèbrent une certaine identité perdue ou réprimée ; la phase B qu'elle décrit comme une "agitation patriotique" (patriotic agitation) au cours de laquelle les gens deviennent beaucoup plus conscients des enjeux et où des sentiments nationalistes plus générale font surface ; la phase C, enfin, est la "montée d'un mouvement de masse" (rise of a mass movement) où prend place l'action collective pour la reconnaissance et même l'indépendance nationales.
L'argument de Balcells est que ce qui est essentiel, c'est l'interaction entre ces dynamiques sociales et ce qu'elle appelle, selon la terminologie du politologue Keith Darden, une "révolution scolastique" (scolastic revolution). Cela correspond à la première génération de personnes qui reçoit une éducation de masse et à l’instant où une communauté passe d’une culture de masse orale à alphabétisée. Le point important en ce qui concerne la France, c'est qu’un Etat solide était en place à l'époque de la révolution scolastique, ce qui signifie que les sentiments nationalistes catalans n’ont obtenu aucun temps d'antenne à l'école.
En Espagne, où l'Etat central n’a pas été présent de manière efficace à la périphérie, la scolarisation de masse est arrivée juste au moment où la phase B était pleinement à l’œuvre. Par conséquent, l'Etat ne pouvait pas contrôler l'enseignement de nationalisme catalan à l'école. La première génération de personnes à avoir été scolarisée a été socialisée en intégrant des idées favorables à la cause du nationalisme catalan. De l'avis de Darden, la "révolution scolastique" est un "moment critique" dans la formation de l'identité qui persiste alors durablement au fil du temps, même face à des tentatives visant à la réprimer. Balcells montre que c'est précisément ce qui est arrivé en Catalogne durant la dictature de Franco. Le facteur critique qui provoque la divergence entre le nord et le sud de la frontière entre la France et l’Espagne en termes de nationalisme catalan était que l'Etat espagnol était faible au mauvais temps, c’est-à-dire lorsque la révolution scolaire a interagi avec une vague d'agitation patriotique. »
Daron Acemoglu & James Robinson, « What’s the problem with (Spanish) Catalunya? », in Why Nations Fail (blog), 4 mars 2014. Traduit par Martin Anota
mardi 4 février 2014
Démocratie versus inégalités
Par Martin Anota le mardi 4 février 2014, 17:00 - Répartition et inégalités de revenu

« Dans son discours sur l'État de l'Union, le président Obama a promis de se concentrer sur les inégalités économiques au cours des deux dernières années de son mandat. Mais beaucoup doutent de la capacité de la démocratie américaine à renverser leur augmentant. En effet, les inégalités de salaires et de revenus ont continué à augmenter au cours des quatre dernières décennies, que ce soit au cours des périodes d'expansion ou de contraction de l’activité économique. Mais ces tendances ne sont pas spécifiques aux États-Unis. De nombreux pays de l'OCDE ont également connu une augmentation des inégalités salariales au cours des dernières décennies.
Que les écarts entre riches et pauvres se creusent dans des démocraties établies est une chose assez déroutante. Les modèles de la démocratie se fondent sur l'idée que l'électeur médian utilisera son pouvoir démocratique pour redistribuer les ressources au détriment des riches et à son propre bénéfice. Lorsque l'écart entre les riches (ou le revenu moyen) et l'électeur médian (qui est proche de la médiane dans la répartition des revenus) s’accroît, cette tendance à la redistribution devrait être plus forte. En outre, comme Meltzer et Richard l’ont souligné dans leur article séminal, plus une société est démocratique (plus la base électorale est large), plus la redistribution devrait être forte. Il s'agit d'une simple conséquence du fait qu’avec un plus large électorat, élargi vers le bas de la distribution des revenus, l'électeur médian sera plus pauvre et plus favorable à une redistribution au détriment des riches (…).
Malgré la robustesse de ces prédictions, les conclusions empiriques sur le sujet sont décidément bien mitigées. Notre récente étude, réalisée conjointement avec Suresh Naidu et Pascual Restrepo, "Democracy, Redistribution and Inequality", revisite ces questions. Théoriquement, nous expliquons pourquoi la relation entre démocratie, inégalités et redistribution peut être plus complexe et donc plus ténue que ce que l’on a pu suggérer ci-dessus.
Tout d'abord, la démocratie peut être "capturée" ou "contrainte". En particulier, même si la démocratie modifie clairement la répartition du pouvoir de jure dans la société, les inégalités et les politiques ne dépendent pas seulement de la répartition du pouvoir de jure, mais aussi de la répartition du pouvoir de facto. C'est une chose que nous avions déjà affirmée dans notre précédent article "Persistence of Power, Elites and Institutions". Les élites qui voient leur pouvoir de jure s’éroder avec la démocratisation peuvent investir suffisamment dans le pouvoir de facto, par exemple en contrôlant l'application locale de la loi et en mobilisant des acteurs armés non étatiques, en pratiquant le lobbying ou en capturant le système des partis. Cela leur permettra alors de garder leur contrôle du processus politique. Si c'est le cas, nous n’observerons qu’un faible impact de la démocratisation sur la redistribution et sur les inégalités. Même si elle n’est pas capturée, la démocratie peut être contrainte soit par d’autres institutions de jure comme les Constitutions, les partis politiques conservateurs et l’appareil judiciaire, soit de facto par des menaces de coups d’Etat, de fuite des capitaux ou d'évasion fiscale émanant de l'élite.
Deuxièmement, la démocratie peut conduire à des "opportunités de marché accroissant les inégalités" (inequality-increasing market opportunities). Les régimes non démocratiques peuvent exclure une grande partie de la population de professions productives, par exemple, des emplois qualifiés et de l'entrepreneuriat, comme cela a pu être illustré par l'apartheid en Afrique du Sud et peut-être par l'Union soviétique. Dans la mesure où cette population est très hétérogène, la liberté de prendre part à des activités économiques sur le même terrain de jeu que l'ancienne élite peut finalement conduire à un accroissement des inégalités au sein du groupe exclu ou réprimé et par conséquent dans l’ensemble de la société.
Finalement, conformément à la "loi de Director" formulée par Stigler, la démocratie peut transférer le pouvoir politique à la classe moyenne et non aux pauvres, auquel cas la redistribution des revenus peut au final augmenter les inégalités car elle risque de s’opérer au seul bénéfice de la classe moyenne.
Donc, la théorie peut ne pas être aussi catégorique l'on aurait pu le penser de prime abord. Mais qu'en est-il des faits ? C'est là que la littérature antérieure se révèle pleine de controverses. Certains ont constaté que la démocratie avait tendance à réduire les inégalités et d’autres non. Nous affirmons que ces questions ne peuvent être facilement résolues avec des régressions transversales (c’est-à-dire en comparant les pays les uns avec les autres) parce que les régimes démocratiques diffèrent significativement des régimes non démocratiques en de nombreuses dimensions. Notre analyse empirique s’appuie sur des régressions sur données de panel (avec des effets fixes) à partir d'un échantillon pour la période d'après-guerre.
Les faits sont intrigants. Premièrement, il y a un effet robuste et quantitativement large de la démocratie sur les recettes fiscales en pourcentage du PIB (et aussi sur les recettes totales du gouvernement en pourcentage du PIB). La démocratie se traduit à long terme par une hausse de 16 % des recettes fiscales en proportion du PIB. Deuxièmement, il y a aussi un impact significatif de la démocratie sur la scolarisation secondaire et sur l’ampleur de la transformation structurelle, par exemple sur la part non agricole de l'emploi ou de la production. Troisièmement, et ce à l'opposé de ces deux premiers résultats, il y a un effet beaucoup plus limité de la démocratie sur les inégalités. La démocratie ne semble pas beaucoup affecter les inégalités. Bien que cela puisse refléter une mauvaise qualité des données relatives aux inégalités, il semble plus probable que cela reflète un manque de corrélation entre démocratie et inégalités. En fait, nous trouvons que la démocratie a des effets hétérogènes sur les inégalités et ce de façon cohérente avec les théories mentionnées ci-dessus, ce qui n’aurait pas été possible si la mauvaise qualité des données relatives aux inégalités compliquait l’obtention d’une quelconque relation empirique. Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que la démocratie opère une réelle redistribution du pouvoir politique au détriment des élites et qu’elle a des répercussions de premier ordre sur la redistribution des revenus et les politiques publiques. Mais l'impact de la démocratie sur les inégalités apparaît plus limité que l'on aurait pu s'y attendre.
Bien que notre travail ne nous donne pas les raisons pour lesquelles il en est ainsi, il existe plusieurs hypothèses plausibles. L'impact limité de la démocratie sur les inégalités peut s’expliquer par le fait que ces dernières sont "induites par le marché" dans le sens où elles sont provoquées par le progrès technique. Mais cela peut également s’expliquer par la loi de Director : les classes moyennes utilisent la démocratie pour orienter la redistribution en leur faveur. Mais la loi de Director ne peut expliquer l'incapacité du système politique des États-Unis à combattre les inégalités, car les classes moyennes ont été largement perdantes avec l’accroissement des inégalités. Se pourrait-il que la démocratie américaine soit capturée ? Cela semble peu probable quand on la regarde du point de vue de nos modèles de démocraties capturées. Mais il y a peut-être d'autres manières de réfléchir à ce problème (…). »
Daron Acemoglu et James Robinson, « Democracy vs. inequality », in Why Nations Fail, 30 janvier 2014. Traduit par M.A.
aller plus loin…. lire « La démocratie réduit-elle les inégalités ? »
« billets précédents - page 1 de 5