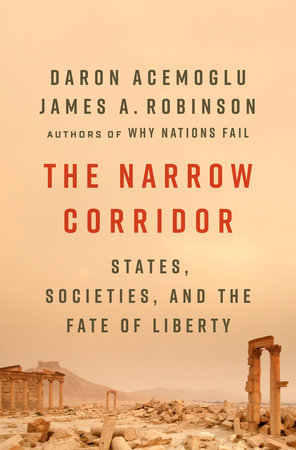« Jusqu’à récemment, les économistes avaient en général minimisé le rôle de la mondialisation dans le creusement des inégalités au sein des pays développés. Mais aux yeux de la population, les effets adverses de la mondialisation semblaient bien plus larges, ce qui a contribué au contrecoup à l’encontre de l’orthodoxie politique et à l’essor du populisme d’extrême-droite. La littérature sur le commerce et les inégalités est pourtant exceptionnellement riche, offrant aussi bien d’importantes intuitions théoriques que de constats empiriques bien complets couvrant la période récente. Dans ces commentaires, je vais résumer quelques points importants à en retenir.
La redistribution est le revers des gains à l’échange
La théorie économique fournit un point de départ naturel. La théorie orthodoxe suggère que les effets redistributifs de l’ouverture aux échanges sont larges et durables. Deux de ces implications (la magnitude et la permanence de la redistribution) sont soutenues dans la théorie du commerce (…). Les gains à l’échange découlent de la différence dans les prix relatifs qui prévalent dans l’économie mondiale, d’un côté, et dans l’économie domestique (en autarcie) avant échanges, de l’autre. A mesure que l’économie s’ouvre aux échanges, les prix relatifs domestiques changent, ce qui entraîne une redistribution des revenus en plus des gains à l’échange. L'identité des gagnants et des perdants dépend de la nature de la stratification sociale dans la société (la classe sociale, la profession, les compétences, le niveau d’éducation, le genre, la religion, etc.) et de quel côté du changement des prix relatifs se situe chaque groupe.
Le fameux théorème Stolper-Samuelson (1941) (...) montre que le commerce génère des pertes absolues pour un segment de la société et non simplement des pertes relatives. Les hypothèses derrière le théorème sont extrêmes : il n’y a que deux facteurs de production, deux biens et une mobilité parfaite des facteurs, mais la logique de Stolper-Samuelson se retrouve dans un ensemble bien plus large d’environnements économiques. Dans une économie concurrentielle, et ce aussi longtemps que l’économie nationale ne se spécialise pas totalement (par exemple, elle continue de produire des biens qui sont importés), l’ouverture au commerce détériore la situation d’au moins un facteur de production, indépendamment du nombre de biens et de facteurs et du degré de mobilité des facteurs (voir Rodrik 2018a pour la démonstration).
Chose importante, ce résultat implique que les effets du commerce international sur les prix à la consommation ne compensent jamais complètement les perdants. C’est une conséquence du fait que, dans un système de production néoclassique, le prix des facteurs varie davantage que le prix des biens. Cela amène à conclure qu’il y aura au moins un facteur de production dont le revenu chutera davantage que le prix du bien qui connait la plus forte baisse de prix. Donc même si les travailleurs les moins qualifiés tendent à consommer beaucoup de produits importables, ils verront toujours leur situation se dégrader quand de tels biens sont intensifs en travail peu qualifié.
Ces résultats théoriques sont importants parce qu’ils vont à l’encontre de beaucoup d’arguments avancés dans le débat public : l’affirmation selon laquelle le commerce bénéficierait à toute la population ou du moins à la plupart des gens ; celle selon laquelle, même si le commerce crée des perdants, il ne s’agirait que de "coûts d’ajustement" transitoires ; ou encore celle selon laquelle l’effet des prix à la consommation ferait plus que compenser les pertes. En substance, il est théoriquement incohérent d’affirmer qu’il y a d'importants gains à l’échange sans accepter l’idée qu’il y ait d’amples répercussions sur la répartition des revenus. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs !
Déceler empiriquement ces effets distributionnels nécessite que nous identifiions précisément les facteurs de production pertinents. Le travail diffère clairement du capital et les travailleurs les moins éduqués ne peuvent se transformer rapidement en professionnels qualifiés. Les premiers travaux empiriques se sont focalisés sur ces distinctions (le travail versus le capital, les travailleurs qualifiés versus les travailleurs non qualifiés), mais ces catégories étaient trop agrégées pour être pleinement révélatrices. Les compétences spécifiques à des entreprises ou des secteurs créent une marge distributionnelle supplémentaire, plus fine, entre les gagnants et les perdants du commerce. Plus important encore, l’immobilité spatiale des travailleurs génère des effets distributionnels entre les régions. Les travaux passés en revue par Dorn et Levell (2021) (…) mettent en évidence les effets nocifs qu’ont pu avoir l’ALENA (aux Etats-Unis) et le choc commercial chinois (aux Etats-Unis et en Europe) sur les marchés du travail locaux dans les régions très dépendantes des emplois qui se sont retrouvés concurrencés par les importations. C’est le cas d’Autor, Dorn et Hanson (2013) concernant le choc commercial chinois et de Hakobyan et McLaren (2016) concernant l’ALENA. Ces études montrent que les régions qui furent très affectées par le commerce (et les travailleurs et secteurs les plus directement concurrencés par la Chine et le Mexique) ont subi des pertes de revenu significatives et durables.
La redistribution est plus large dans les étapes avancées de la mondialisation
Une implication importante, mais bien moins reconnue, de la théorie du commerce international est que les gains tirés du retrait des barrières à l’échange diminuent relativement à la redistribution induite, précisément parce que les barrières en question deviennent de moins en moins importantes. En d’autres mots, la composante redistributive du commerce augmente relativement aux gains globaux à mesure que la mondialisation se poursuit. Ce résultat découle simplement de la théorie économique standard. Les coûts en termes d’efficience d’une taxe sur le commerce, comme avec toutes les taxes, augmentent avec le carré de la taxe. (…) De leur côté, les effets distributifs sont pratiquement linéaires avec les changements des prix relatifs et ils ne dépendent pas de la magnitude de la taxe (ni de l’étape de la mondialisation où nous nous situons).
Pour en voir l’importance pratique, considérons la question suivante : combien de dollars de revenu basculent d’un groupe de revenu à l’autre par dollar de gains à l’échange ? La réponse à cette question est donnée par ce que j’ai appelé le "ratio coût-bénéfice politique" (RCBP) de la libéralisation (Rodrik, 1994). Le numérateur du RCBP est la somme des valeurs absolues des gains et pertes des différents groupes identifiables, divisé par deux (pour corriger de la double comptabilisation). Le dénominateur correspond aux gains d’efficience standards que génère la libéralisation commerciale. Nous pouvons calculer cet indicateur en utilisant les modèles d’équilibre partiel ou général du commerce avec des valeurs de paramètre de référence (pour les élasticités dans le premier cas et les parts des facteurs dans le second). Dans les deux cas, le ratio de redistribution des gains nets passe d'environ 5 quand les droits de douane sont initialement de 40 % à plus de 20 quand les droits de douane sont de 10 % (Rodrik, 1994, 2018a). En d’autres termes, pour de faibles niveaux de barrières à l’échange, la redistribution est relativement plus large que les gains à l’échange qui sont générés. Ce n’est pas qu’une possibilité théorique. Les analyses empiriques de l’ALENA (Romalis, 2007 ; Caliendo et Parro, 2015) ont conclu que les gains à l’échange obtenus par l’économie américaine sont infimes en comparaison avec les effets distributifs mis en lumière, par exemple, par Hakobyan et McLaren (2016).
Ces considérations apportent un éclairage très utile pour l’économie politique de la mondialisation. Une fois que les marchés nationaux sont assez ouverts, les tentatives visant à approfondir la mondialisation vont sembler (non sans raison !) être avant tout motivées par l’objectif d’enrichir certains groupes plutôt que d’accroître la taille du gâteau. Selon moi, les pays développés avaient atteint ce stade à la fin des années 1990, peut-être même plus tôt.
La compensation est problématique
Le commerce international entraîne une redistribution des revenus, mais il n’aggrave pas forcément les inégalités si les bénéficiaires sont les moins fortunés de la société. La théorie et l’analyse empirique suggèrent cependant que la redistribution est allée dans la mauvaise direction dans les pays développés. Les perdants ont été les travailleurs les plus pauvres et les moins éduqués, et les régions qui étaient déjà affectées par la désindustrialisation et les destructions d’emplois provoquées par celle-ci. Les pertes en revenu ont été amplifiées par la hausse des taux de mortalité et d’autres coûts sociaux (Case et Deaton, 2020).
La réponse standard que les économistes et les responsables de la politique commerciale ont avancée à de telles inquiétudes est que les accords commerciaux doivent s'accompagner d’une compensation des perdants. Aux Etats-Unis, la compensation est souvent implicitement intégrée dans la politique commerciale à travers la Trade Adjustment Assistance (TAA). En Europe, la compensation n’est pas directement ciblée sur les travailleurs affectés par le commerce international, mais l’assurance sociale et des politiques actives de l’emploi répondant aux destructions d’emplois en général tendent à être plus généreuses qu’aux Etats-Unis. Dans aucun des deux cas une compensation n'est fournie pour les pertes de rémunération en tant que telles, à moins que les travailleurs basculent dans le chômage ou voient leur revenu chuter en-deçà d’un seuil qui active l’assistance sociale. Il est clair que la compensation est incomplète et imparfaite.
Il y a de bonnes raisons pour lesquelles la compensation ne marche jamais en pratique. Premièrement, il y a des problèmes informationnels qui empêchent de cibler les perdants. Les gouvernements peuvent difficilement identifier les travailleurs dont la rémunération aurait été plus élevée en l’absence de la libéralisation du commerce. En pratique, ce problème est "résolu" en rendant l’assistance publique conditionnelle à un choc commercial observable, par exemple les destructions d’emplois liées au commerce international. Mais cela manque les travailleurs qui ont accepté des salaires plus faibles, que ce soit en gardant leur emploi ou en changeant d’emploi. En général, l’information imparfaite empêche les transferts forfaitaires, ce qui signifie que la compensation crée des inefficiences.
Cela nous amène au second problème. Comme la compensation est coûteuse, la perte sèche de la compensation ampute facilement un gros morceau des gains à l’échange. Elle affaiblit les gains agrégés de la compensation et peut même les transformer en pertes. A travers un modèle de commerce quantitatif, Antràs et alii (2017) montrent que les magnitudes sont significatives : la hausse non compensée des inégalités produite par le commerce peut significativement réduire le bien-être social ; et les distorsions occasionnées par les impôts adoptés pour modérer les inégalités peuvent réduire les gains à l’échange. Dans cette étude, la libéralisation du commerce est modélisée comme une réduction des coûts à l’échange "iceberg", qui ignore la perte dans les recettes douanières du gouvernement. Quand les recettes du gouvernement sont ajoutées, la compensation requise est plus large.
Considérons un calcul au dos de l’enveloppe basé sur les résultats de Rodrik (1994, 2018a) cités plus haut. Supposons que le fardeau excédentaire des politiques redistributives s’élève à 0,10 dollar. En d’autres termes, pour tout dollar de redistribution, il y a une perte sèche équivalente à 10 centimes. Supposons en outre que le RCBP (à la marge) de la libéralisation commerciale soit de 10, ce qui n’est pas un chiffre extrême quand les économies sont déjà pleinement ouvertes (comme je l’ai précédemment indiqué). Alors, compenser pleinement les perdants produirait une perte sèche qui épuiserait tous les gains à l’échange. Avec un RCBP supérieur à 10 et/ou un fardeau excédentaire supérieur à 0,1, la compensation du commerce international provoquerait des pertes nettes pour la société. Des groupes particuliers (les intérêts orientés à l’export) peuvent toujours y gagner et en l’occurrence beaucoup gagner, mais les pertes subies par le reste de la société seraient plus larges.
J’ai jusqu’à présent considéré les arguments économiques expliquant pourquoi la compensation est problématique et au mieux incomplète. L’hypothèse était qu’il y a une fonction de bien-être social qui prend en compte la distribution du revenu et que les autorités politiques veulent maximiser. Mais il y a aussi des raisons politiques qui peuvent empêcher la compensation. Si les bénéficiaires de la mondialisation sont assez puissants pour obtenir les accords commerciaux qu’ils désirent, ils peuvent aussi être assez puissants pour bloquer les politiques redistributives. Et même s’ils ont initialement besoin d’une coalition assez large, ils peuvent se soustraire à leurs engagements.
Une version de cet argument fait écho à l’incohérence temporelle attachée à la promesse de compenser les perdants. Supposons que la signature d’un accord commercial nécessite qu'il soit accepté par au moins certains des potentiels perdants. Dans les pays développés, ces groupes pourraient être les travailleurs dans les régions industrielles en déclin. Pour obtenir leur accord, le gouvernement va vouloir leur promettre un dédommagement. Dans le contexte américain, cela pourrait prendre la forme d’une Trade Adjustment Assistance améliorée. Cependant, dès lors que l’accord commercial ne peut être facilement inversé, il y aura peu d’incitations à accorder la compensation une fois que l’accord est signé. Plus généralement, les promesses de redistribuer ex post présentent une incohérence temporelle quand l’accord commercial sape le pouvoir des acteurs ayant un pouvoir de veto (Fernandez et Rodrik, 1991). En effet, la TAA a généralement été sous-financée et son efficacité a été limitée (D’Amico et Schochet, 2012).
Bref, que ce soit d’un point de vue économique ou politique, il n’est pas surprenant que les perdants de la mondialisation n’aient pas bénéficié d’une telle compensation.
Justice versus inégalités : le commerce international diffère des autres échanges marchands
Mais pourquoi les gouvernements devraient-ils chercher à défaire les effets redistributifs du commerce et la mondialisation ? Les économies de marché subissent continuellement des changements et beaucoup d’entre eux bouleversent les prix relatifs et la répartition du revenu. Les modifications dans les conditions de demande, le changement technologique et une variété d’autres chocs idiosyncratiques frappent les économies sans pour autant susciter des inquiétudes à propos des inégalités ou des appels au dédommagement. En outre, il n’est pas clair que le commerce soit le plus important facteur à l’origine des problèmes distributionnels que les pays développés ont connus ces dernières décennies : la hausse des inégalités salariales, la désindustrialisation, le déclin régional, la compression des classes moyennes, la hausse de la part du revenu rémunérant les hauts revenus et la chute de la part du travail. Il y a un large consensus parmi les économistes pour dire que le progrès technique et de profonds changements institutionnels (tels que le déclin du syndicalisme ou du pouvoir de négociation des travailleurs) ont joué un plus grand rôle. Pourtant, les effets nocifs du commerce international et de la mondialisation sont devenus bien plus saillants politiquement que les autres déterminants. Un large pan de la littérature empirique montre que les chocs de mondialisation ont joué un rôle causal et significatif dans l’essor des mouvements populistes d’extrême-droite (Rodrik, 2021).
Les énormes effets des chocs commerciaux sur les attitudes publiques ont été mis en évidence dans une expérimentation que Rafael di Tella et moi avons réalisée auprès de répondants américains (di Tella et Rodrik, 2020). Dans une enquête menée en ligne à grande échelle, nous avons présenté aux sujets un "article de presse" sur la fermeture imminente d’une usine textile. Nos sujets furent aléatoirement répartis entre différents groupes de traitement, chaque groupe se voyant présenter un scénario particulier l’éclairant sur les raisons de la fermeture de l’usine. Les scénarii évoquaient notamment un choc de demande négatif, l’introduction de technologies économisant le travail, les erreurs de gestion et différents types de délocalisations internationales (donc le commerce international). Il fut demandé aux répondants quelles étaient leurs préférences en termes de politique publique : ils pouvaient choisir de ne rien faire, de verser des revenus de transfert aux travailleurs qui perdaient leur emploi ou d’imposer une restriction au commerce.
En général, les scénarii suscitaient une hausse du soutien en faveur de l’action publique en comparaison avec le scénario de contrôle (celui où il n’y a pas de destructions d’emplois). Mais le principal point était que les gens ne traitaient pas de la même façon les différentes destructions d’emplois. Ils distinguaient les chocs touchant le marché du travail selon ce qui les produisait. Alors que les perturbations non commerciales telles que les chocs technologiques et les chocs de demande n’augmentaient pas la demande de protection, les chocs commerciaux suscitaient une bien plus forte demande de protection, doublant ou triplant la part des répondants qui appelaient à restreindre les échanges internationaux. En outre, nos sujets étaient particulièrement sensibles au commerce avec une nation en développement. Changer simplement le nom du pays où la production est délocalisée (le Cambodge au lieu de la France) augmenta significativement la demande de protection face aux importations (de plus de la moitié).
Ces résultats suggèrent que les gens voient les chocs commerciaux comme intrinsèquement différents des autres types de chocs. Les vues de nos répondants quant à la désirabilité de l’action gouvernementale d’un certain type (et de la restriction au commerce en particulier) ne dépendaient pas seulement des possibles conséquences (les pertes d’emplois), mais aussi des canaux causaux. Les gens semblent également avoir des préférences quant aux mécanismes distributifs.
Angus Deaton, parmi d’autres, estime que les réactions publiques aux tendances économistes sont moins façonnées par les inégalités en tant que telles que par les perceptions de justice. Comme Deaton (2017) l’écrit, "les inégalités ne sont pas la même chose que l’injustice… C’est cette dernière qui suscite aujourd’hui tant de troubles politiques dans le monde riche. Une partie des processus qui génèrent les inégalités est perçue comme juste. Mais les autres processus à l’œuvre sont profondément et manifestement injustes et ils sont devenus une source légitime de colère et de désaffection". Le commerce international est particulièrement susceptible de susciter des sentiments d’injustice, parce qu’il implique des transactions économiques entre des entités opérant dans différents ensembles de règles et de réglementations.
Considérons la différence entre un échange marchand qui est domestique et un second qui implique un passage aux frontières. Dans le premier cas, toutes les entreprises opérant dans un secteur donné sont sujettes à des règles identiques (établies par le gouvernement national) et le sentiment est que l’Etat n’en favorise aucune par rapport aux autres. En d’autres termes, les règles du jeu semblent les mêmes pour toutes. Dans le second cas, les entreprises ne font pas forcément face aux mêmes circonstances. Une entreprise dans un pays A peut être (explicitement ou implicitement) subventionnée par son gouvernement et elle peut avoir à respecter des normes environnementales et une réglementation du travail bien plus souples que celles qui prévalent dans le pays B ou bien, même si les réglementations sont dans le texte les mêmes, elle peut les contourner. D’un point de vue économique formel, l’écart de coûts entre les pays qui en résulte n’est pas différent de celui qui résulte des différences dans les dotations factorielles ou en termes de productivité, si bien qu’il peut même être la source de gains à l’échange additionnels. Mais les opportunités de commercer qui résultent d’une telle inégalité des règles du jeu ne sont pas de la même nature et elles ont un relent d’injustice.
Les économistes ont traditionnellement résisté à l’idée d’évoquer de telles questions d’injustice dans les discussions autour de la politique commerciale. Si la réglementation du travail est superficielle ou inexistante dans les pays à faible revenu, pourquoi ne pas considérer cela comme une autre source d’avantage comparatif ? Les travailleurs qui perdraient leur emploi dans les ateliers textile si le commerce était restreint ne se retrouveraient-ils pas alors dans une plus mauvaise situation qu’en l’absence d’opportunités offertes par l’ouverture commerciale ? Fait-il économiquement sens de délocaliser les productions polluantes dans les juridictions où la demande d’un air plus propre est plus faible et donc les réglementations environnementales plus laxistes ?
Considérons ces inquiétudes du point de vue des groupes affectés, en particulier les travailleurs, dans le pays importateur. Après de longues luttes politiques, les travailleurs dans la plupart des pays développés ont obtenu une expansion considérable des droits sociaux, notamment dans le cadre de la réglementation du travail avec la liberté des négociations collectives et la prohibition du travail forcé et du travail des enfants. Avec cette réglementation du travail, il est illégal (et illégitime) pour les entreprises de se concurrencer sur le base d’avantages en coûts obtenus en violant ces normes. Une entreprise ne peut concurrencer une autre entreprise en employant des travailleurs qui se soustraient à la réglementation du travail nationale, même si ces travailleurs désirent le faire "volontairement".
Mais le commerce international rend soudainement légal (et, aux yeux de beaucoup d’économistes et de technocrates, pleinement légitime) ce qui était jusqu’alors illégal (et illégitime) dans un pays. Une entreprise ne peut pas venir de l’étranger des enfants et les faire travailler dans son pays, mais elle peut employer ces enfants à l’étranger (soit directement, soit via un sous-traitant). Un économiste y voit des gains à l’échange. Mais pour le défenseur du travail et le réformateur social, il s’agit d’une sape de la réglementation du travail domestique. Effectivement, les travailleurs domestiques se voient dire : si vous ne voulez pas être concurrencés par les importations, vous devez sacrifier les droits du travail que vous avez durement acquis !
Dans certains cas, les lois du commerce international reconnaissent le besoin d’accorder un minimum d’attention aux considérations de justice. C’est pourquoi les pratiques de subventions à l’export et de dumping (consistant à vendre à un prix inférieur aux coûts) de la part des exportateurs sont généralement punissables par des "remèdes" commerciaux (c’est-à-dire des droits de douane sur les importations) même s’il est économiquement peu justifié de le faire. Le travail carcéral a été laissé en-dehors des règles commerciales dans le GATT originel (permettant aux pays de restreindre les importations réalisées avec un tel travail). Une exception similaire n’a formellement pas été faite pour les biens réalisés avec du travail forcé, mais l’on peut penser que peu élèveraient une objection à ce que des prohibitions commerciales allant dans ce sens soient adoptées. Mais que dire à propos du travail d’enfants, des pratiques d’exploitation du travail ou de la répression flagrante des droits de négociation collective ? Dans tous ces cas, il peut être justifié de parler d’injustice à propos d’un tel commerce. Pourtant, les règles actuelles ne permettent généralement pas aux pays de restreindre les importations sur la base de telles considérations (en-dehors d’accords commerciaux bilatéraux ou régionaux). Prohiber ou restreindre les importations en raison de violations de droits du travail dans les pays exportateurs violerait les règles de l’OMC et pourrait susciter des représailles de la part des exportateurs affectés.
Les différences réglementaires entre les pays ne sont pas toujours problématiques. Elles peuvent s’expliquer par des différences en termes de circonstances ou de préférences et elles ne reflètent pas forcément une violation des droits sociaux. Par exemple, un pays exportateur peut avoir un salaire minimum relativement faible qui reflète un moindre niveau de productivité. Cela n’est clairement pas une source de nivellement par le bas des conditions de travail dans les pays importateurs et ils ne doivent pas y voir un échange déloyal (bien qu’en pratique ils le fassent souvent). Dans d’autres cas, les pays peuvent choisir une moindre protection sociale et une protection plus souple du travail pour atteindre d’autres objectifs sociaux (par exemple un niveau d’emploi plus élevé). Des considérations d’arbitrage vont toujours entrer en jeu, même s’il n’y a pas de violation des droits dans les pays aux réglementations laxistes. C’est l’une des considérations qui a fortement pesé dans les négociations de l’Union européenne avec la Grande-Bretagne pour le Brexit.
Les considérations de justice dans le commerce international n’appellent pas à l’uniformité des réglementations du travail ou des règles sociales. Mais en général, plus l’intégration est poussée, plus forte sera la demande pour l’harmonisation des réglementations. Dans l’Union européenne, la divergence dans les règlementations du travail entre certains pays périphériques (par exemple la Pologne) et les nations plus avancées (par exemple la France) a souvent créé des tensions. A travers l’accord du Brexit, l’Union européenne a obtenu la promesse de la part de la Grande-Bretagne que cette dernière de concurrencerait pas déloyalement ses industries par des règlementations du travail et des normes environnementales plus souples (et elle s’est réservé le droit à restreindre les échanges si des changements en matière de politiques du travail, sociales ou environnementales au Royaume-Uni présentaient des "impacts significatifs sur le commerce ou l’investissement entre les parties").
L’intégration économique se fait avec un arbitrage entre, d’un côté, les gains à l’échange et, de l’autre, les gains de la diversité réglementaire. Il est en général impossible de maximiser sur les deux fronts. Plus nous approfondissons l’intégration, plus nous devons sacrifier en diversité réglementaire, soit de jure, soit de facto, via l’arbitrage. (Je discute davantage de l’harmonisation réglementaire dans la prochaine section.) Sans prétendre résoudre de tels problèmes, les économistes peuvent néanmoins faire savoir que le commerce international soulève dans de telles conditions d’épineuses questions de justice.
Les bénéfices d’une intégration profonde sont ambigus
Les économistes considèrent typiquement la politique commerciale internationale en termes de droits de douane et de quotas. Mais comme mes propos précédents le suggèrent, au fil du temps la politique commerciale a de moins en moins concerné ces frictions si souvent évoquées dans les manuels pour s’attaquer de plus en plus aux autres barrières rendant l’accès aux marchés domestiques coûteux. L’idée était que, comme les barrières traditionnelles disparaissaient, des gains à l’échange supplémentaires pouvaient être obtenus en réduisant les coûts de transaction générés par les politiques ou les réglementations qui étaient traditionnellement considérées comme relevant du seul ressort domestique. L’agriculture, les services, les subventions, la santé et les règles sanitaires ou encore la protection de la propriété intellectuelle ont été certains des nouveaux domaines incorporés à l’OMC en 1994. Les accords commerciaux qui ont été ultérieurement négociés de façon bilatérale ou régionale sont même allés plus loin dans ces domaines et ont intégré d’autres domaines comme la banque, la finance et la réglementation du travail. Le problème est que les politiques domestiques dans ces domaines assuraient souvent d’importantes fonctions distributives ou étaient le fruit de négociations sociales historiques. Quand elles se retrouvèrent incorporées dans les négociations commerciales, beaucoup ont estimé que des groupes spécifiques et des lobbies s’étaient approprié les accords commerciaux pour renverser les pactes sociaux. Les accords commerciaux devinrent plus conflictuels et controversés.
Mais ce n’est pas seulement une question de perceptions. Le contrecoup politique à l’encontre de l’intégration profonde peut trouver des justifications économiques. Les bénéfices économiques agrégés tirés des accords internationaux contraignant l’autonomie réglementaire domestique sont bien plus ambigus que ceux tirés du retrait des barrières frontalières traditionnelles. Ils peuvent certes réduire les "coûts à l’échange" et stimuler les échanges et l’investissement transfrontalier. Mais leur impact sur le bien-être et l’efficience est fondamentalement incertain. Je discute en détails de ces questions dans Rodrik (2018b) ; voir aussi Maggi et Ossa (2020).
Considérons le cas des normes réglementaires (conçus pour promouvoir la sécurité du consommateur, la protection de l’environnement ou de la santé). L’harmonisation de telles normes réglementaires est au cœur des accords commerciaux d’aujourd’hui. La justification est que la réduction des différences réglementaires entre les pays diminue les coûts de transaction qu’il y a à faire des affaires à l’étranger. Les normes réglementaires qui peuvent entraver l’accès des producteurs étrangers aux marchés domestiques sont parfois qualifiées de "barrières non douanières". Et il ne fait guère de doute que les gouvernements jouent parfois sur les réglementations pour donner un avantage aux producteurs domestiques face aux producteurs étrangers. Mais, comme je l’ai indiqué plus tôt, les différences en matière de réglementation entre les pays reflètent souvent des différences en matière de préférences des consommateurs ou une divergence dans les styles réglementaires. L’interdiction des OGM et du bœuf aux hormones, par exemple, ne répond pas à des motifs protectionnistes (cette interdiction s’applique également aux producteurs domestiques), mais aux pressions émanant de groupes de consommateurs domestiques. Le gouvernement américain considère qu’il s’agit de barrières protectionnistes et les organes de règlement des différends de l’OMC lui ont souvent donné raison (Rodrik, 2018b).
Le problème est que, contrairement au cas des droits de douane et des quotas, il n’y a pas de référence naturelle qui nous permette de déterminer si une norme réglementaire est excessive ou "protectionniste". Comme les pays ne partagent ni les mêmes évaluations du risque (de sécurité, environnemental, sanitaire), ni les mêmes conceptions du lien qui doit s’établir entre les entreprises et leurs parties prenantes (leurs salariés, leurs fournisseurs, leurs clients, les communautés locales), les normes ne seront pas les mêmes et aucune ne sera supérieure aux autres. Dans le langage des économistes, les normes réglementaires sont des biens publics pour lesquels les nations (et les groupes dans les nations) peuvent avoir des préférences différentes. Les nations doivent arbitrer entre les bénéfices d’un approfondissement de l’intégration des marchés (en réduisant la diversité réglementaire) et les coûts d’une harmonisation excessive. Les décisions qui en résultent sont intrinsèquement politiques et distributionnelles. Et elles restent contestées comme les préférences et les coalitions politiques changent.
L’Acquis communautaire européen constitue le summum de l’harmonisation réglementaire. Le Marché unique européen est le résultat de la poursuite non simplement du libre-échange, mais en fait de la profonde intégration, qui a requis un large ensemble détaillé de lois et de réglementations (allant jusqu’à prescrire, par exemple, la taille des cages pour les poules pondeuses) qui s’appliquent pour la plupart à tous les Etats-membres. Ces arbitrages ont fortement pesé dans le débat autour du Brexit au Royaume-Uni. Ses partisans appelaient notamment à ce que telles décisions restent entre les mains des politiciens domestiques (plutôt que des technocrates européens). Le maintien dans l’Union européenne impliquait que les arbitrages importants soient réalisés à Bruxelles, loin des dirigeants démocratiquement élus, et qu’ils seraient susceptibles de favoriser le marché unique au détriment de la différence nationale.
C’était peut-être un genre différent de conflit distributif, tournant moins autour des intérêts matériels et davantage autour des valeurs ou des préférences sociales et politiques. Pour ceux ayant d’importants intérêts commerciaux, économiques ou professionnels à accéder au marché européen, il était naturel que les intérêts matériels prédominent. Pour d’autres, pour qui les perspectives économiques étaient moins brillantes, l’autonomie politique et réglementaire revenait à la surface.
Il n’est pas certain qu’il y ait des gains à l’échange "dynamiques"
Les gains standards du commerce sont des effets de "niveau", statiques, qui résultent d’une allocation plus efficace des ressources domestiques, étant donné les possibilités d’échanges. Il est possible d’envisager également des effets de croissance dynamiques ou des bénéfices de productivité qui vont au-delà des gains standards dans l’efficience allocative. En l’occurrence, une ouverture aux échanges peut augmenter, non pas seulement ponctuellement les possibilités de consommation, mais en fait le taux de croissance de la productivité de l’économie. Les avocats des accords commerciaux évoquent souvent de tels effets de croissance ou de productivité pour affirmer qu’il y a de larges gains économiques. Beaucoup des problèmes distributionnels que j’ai évoqués seraient d’une moindre importance si la croissance économique accélérait de façon soutenue. Tous les bateaux (ou la plupart d’entre eux) ont plus de chances de finir par être soulevés si la marée ne cesse de monter.
Les effets de croissance peuvent découler soit d’une hausse de l’accumulation du capital, soit d’une accélération de l’innovation et de sa diffusion. Notez tout d’abord qu’une hausse de la croissance à moyen ou long terme n’implique pas en soi une hausse équivalente du bien-être. Supposons, par exemple, que l’ouverture aux échanges accroisse le rendement domestique du capital et donc le taux d’investissement, en plus du taux de croissance à long terme. En l’absence d’une divergence entre les rendements privés et sociaux de l’accumulation, les coûts d’opportunité de la consommation perdue à court terme (de façon à accroître l’épargne et à financer l’investissement) sont égaux à la marge à la hausse des possibilités de consommation à long terme. Dans ce cas, les gains à l’échange, calculés par approximation, ne seraient pas différents des gains statiques standards, malgré la hausse du taux de croissance de l’économie.
Les effets de croissance significatifs pour le bien-être sont davantage probables quand le commerce améliore la productivité dans les secteurs, soit dans les entreprises, soit par la réallocation entre les entreprises, et quand il y a des externalités positives associées au processus d’innovation. Tout d’abord, le commerce facilite les transferts technologiques à partir des entreprises situées à la frontière technologiques dans les autres pays (Bayoumi et alii, 1999). Un autre mécanisme est celui de la concurrence à l’importation, qui force les entreprises les moins efficaces à sortir du marché et d’autres entreprises à rationaliser leur exploitation (Melitz, 2003). De tels effets sont abondamment documentés et le commerce est en général associé à une plus forte croissance de la productivité dans les secteurs les plus exposés à l’économie mondiale tels que l’industrie manufacturière.
Il est moins souligné que la croissance de la productivité induite par le commerce dans l’industrie ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de ce qui importe vraiment pour les gains agrégés, en l’occurrence la croissance de la productivité au niveau de l’économie. Dans plusieurs pays à revenu intermédiaire ou élevé, en particulier la Grande-Bretagne, la concurrence à l’importation a accéléré le processus de désindustrialisation. La question clé est de savoir ce qui survient au travail qui a été réalloué à d’autres secteurs lorsque l’industrie se contracte. Quand le travail se déplace vers les activités de services à moindre productivité, où les externalités technologiques sont moins importantes, ou quand l’emploi reste déprimé dans les régions affectées, les effets au niveau de l’ensemble de l’économie sont considérablement moins positifs. Le déclin économique local et la désindustrialisation ont été liés non seulement à une moins bonne performance en termes de productivité, mais également à divers maux sociaux allant des ruptures conjugales à la multiplication des problèmes d’addiction et des suicides (Case et Deaton, 2020). La spécialisation de la Grande-Bretagne s’est faite au profit des services financiers et elle a promu une livre sterling forte, mais au détriment de nombreux pans de l’économie réelle.
Et à propos des pays exportateurs à faible revenu ? Il est indéniable que la croissance dans plusieurs de ces pays (et en Chine en particulier) a bénéficié de l’ouverture des marchés en Europe et aux Etats-Unis. L’industrialisation orientée à l’exportation a été un puissant moteur pour la croissance dans les pays qui réussirent à l’allumer. Donc même si le commerce a aggravé les inégalités dans les pays développés, il a probablement réduit les inégalités mondiales, grâce en grande partie à la performance économique de la Chine.
Cependant, il est utile de souligner deux points ici (…). Premièrement, les pays qui ont réussi à s’industrialiser se sont appuyés sur une vaste gamme de politiques qui violèrent les règles d’intégration profonde. La Chine s’est industrialisée non seulement en protégeant pendant un long moment ses entreprises publiques de la concurrence à l’importation, mais aussi à travers les subventions, les transferts technologiques forcés, les exigences en contenu domestique, la manipulation du taux de change et un laxisme en matière de protection des brevets et des copyrights. Deuxièmement, mis à part la Chine, les exemples les plus proéminents d’industrialisations orientées à l’exportation (le Japon, la Corée du Sud, Taïwan) prirent place avant les années 1990, quand les restrictions à l’échange dans les pays développés étaient généralement plus fortes et la libéralisation du commerce confinée à la question des barrières frontalières.
La globalisation financière et la mobilité du capital aggravent les inégalités
Jusqu’à présent je ne me suis focalisé que sur le commerce international, mais mes propos seraient incomplets si je n’évoquais pas les effets distributifs de la mobilité internationale des entreprises et de la mondialisation financière.
Les chercheurs du FMI ont constaté qu’une plus grande mobilité du capital produit de puissants effets d’inégalités (Jaumotte et alii, 2013 ; Furceri et Loungani, 2015 ; Furceri et alii, 2017). En l’occurrence, ils constatent que la libéralisation du compte de capital entraîne des baisses significatives et durables de la part du revenu rémunérant le travail, ainsi que des hausses du coefficient de Gini des inégalités de revenu et des parts du revenu national gagnées par les 1 %, les 5 % et les 10 % les plus rémunérés.
Il n’y a pas d’analogue au théorème Stolper-Samuelson en macroéconomie internationale. Mais il y a une explication évoquant les négociations (comme je l’ai développé dans Rodrik, 1997, chapitre 2). Aussi longtemps que les salaires sont en partie déterminés par la négociation entres les salariés et leurs employeurs, la mobilité du capital donne à ces derniers un moyen de pression crédible : acceptez de plus faibles salaires ou nous irons à l’étranger ! Furceri et alii (2017) constatent empiriquement que la déformation du partage du revenu au détriment du travail est liée aux menaces de délocalisations. L’explication par les négociations est aussi cohérente avec le constat relevé par Jaumotte et alii (2013) selon lequel la hausse des inégalités est étroitement liée à l’investissement direct à l’étranger. Plus largement, le régime de négociations salariales peut être endogène à la mondialisation, les travailleurs perdant en pouvoir de négociation à mesure que les délocalisations de la production à l’étranger sont facilitées.
Un autre argument dans Rodrik (1997) est que la mobilité du capital accroit la volatilité des rémunérations du travail et déplace le fardeau des chocs économiques sur les épaules des travailleurs. Cela découle aussi du fait que le capital et le travail n’ont pas le même degré de mobilité internationale. Le facteur qui a le moins de possibilités à quitter le pays se retrouve à supporter les coûts des chocs idiosyncratiques. Les analyses empiriques vont dans le sens de cette conjecture (Scheve et Slaughter, 2002 ; OCDE, 2007 ; Buch et Pierdzioc, 2014). Les travailleurs les moins compétents et qualifiés, ceux qui sont les moins à même de traverser les frontières, sont typiquement les plus affectés par le déplacement des risques.
Un autre changement distributionnel tient au fardeau de la taxation. Quand le capital devient mondialement mobile, il devient plus dur à taxer. En effet, les taux d’imposition des entreprises ont fortement baissé dans pratiquement tous les pays développés depuis la fin des années 1980, dans certains cas de moitié, voire plus. De telles tendances ont été explicitement reliées à la concurrence fiscale dans les pays avec des régimes de libre mobilité du capital (Devereux et alii, 2008). Entretemps, le fardeau fiscal sur les salaires (les cotisations sociales, etc.) n’a guère changé et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont généralement augmenté (Rodrik, 2018a).
Il y a eu une bien plus grande coopération et davantage d’échanges d’informations entre les pays développés ces dernières années en vue de restreindre la concurrence fiscale. Un accord a récemment été obtenu parmi les principales économies pour fixer un plancher dans la taxation du revenu des entreprises. Il reste à voir si cela va entraîner un réel changement dans la taxation du capital mondialement mobile. »
Dani Rodrik, « A primer on trade and inequality », août 2021. Traduit par Martin Anota
aller plus loin…
La mondialisation creuse les inégalités dans les pays développés
Baisse de la part du travail : la mondialisation est-elle coupable ?
Quel est l’impact de l’ouverture financière sur les inégalités de revenu ?
Quels sont les effets de la libéralisation financière ?
Pourquoi la mondialisation alimente-t-elle le populisme ?