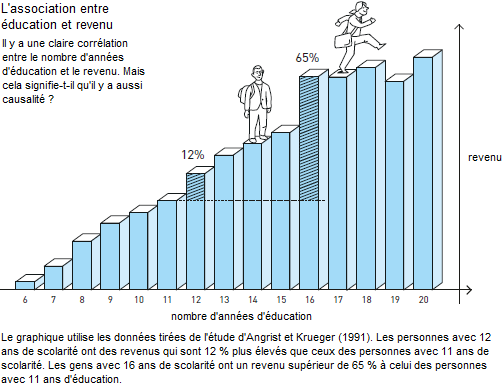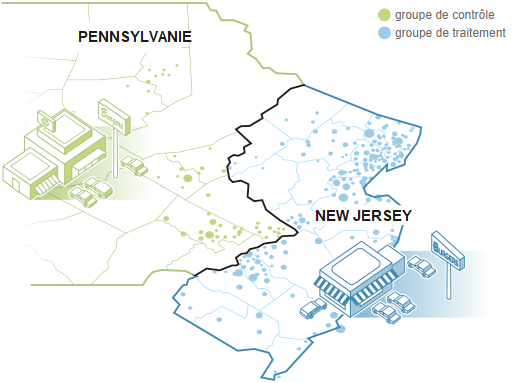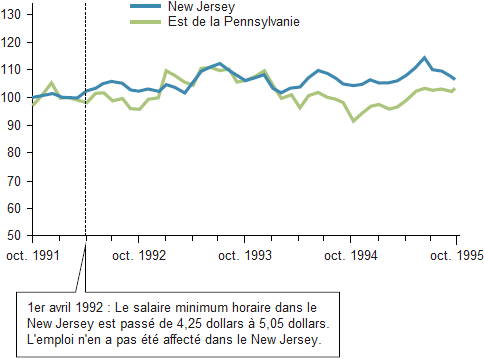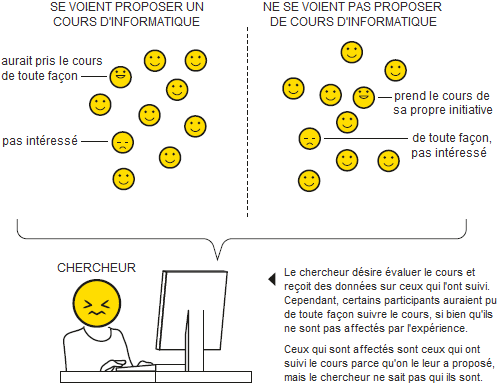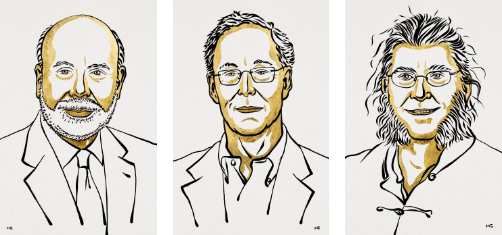
« La Grande Dépression des années 1930 a paralysé les économies à travers le monde pendant plusieurs années et elle a eu de désastreuses conséquences sociétales. Cependant, nous avons réussi à mieux gérer les crises financières ultérieures grâce aux travaux des lauréats de cette année, Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig. Ils ont démontré qu’il est important de prévenir les effondrements généralisés des banques...
Nous sommes tous liés d'une façon ou d'une autre aux banques. Nos revenus sont versés sur un compte bancaire et nous utilisons les moyens de paiement des banques, que ce soit les applications mobiles ou des cartes bancaires, quand nous faisons des achats dans un supermarché ou payons une note de restaurant. A certains moments de notre vie, beaucoup d’entre nous ont besoin d’emprunter auprès des banques, par exemple pour acheter une maison ou un appartement. C’est également le cas pour les entreprises : elles ont besoin de pouvoir faire régler leurs transactions et de financer leurs investissements. Dans la plupart des cas, ces services sont aussi fournis par une banque.
Nous considérons comme garanti que ces services fonctionnent comme ils le doivent, sauf par moments en raison de brefs problèmes techniques. Parfois, cependant, l’ensemble ou une partie du système bancaire dysfonctionne et une crise financière survient. Des banques s’effondrent, il devient plus cher voire impossible d’emprunter, les prix plongent sur les marchés de l’immobilier ou d’autres actifs. Si cette progression n’est pas stoppée, l’économie entière peut entrer dans une spirale baissière avec la hausse du chômage et la multiplication des faillites de banques. Certains des plus grands effondrements économiques au cours de l’Histoire ont été des crises financières.
D’importantes questions à propos des banques
Si les difficultés des banques peuvent provoquer autant de dommages, pouvons-nous nous passer des banques ? Les banques ont-elles nécessairement à être aussi instables et, dans ce cas, pourquoi ? Comment la société peut-elle améliorer la stabilité du système bancaire ? Pourquoi les conséquences d’une crise bancaire durent-elles aussi longtemps ? Et, si les banques font faillite, pourquoi de nouvelles banques ne peuvent-elles pas immédiatement être mises en place de façon à ce que l’économie puisse rapidement être remise sur pieds ? Au début des années 1980, les lauréats de cette année, Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig ont posé dans trois articles les fondements scientifiques pour la recherche moderne portant sur ces questions.
Diamond et Dybvig ont développé des modèles théoriques qui expliquent pourquoi les banques existent, comment leur rôle dans la société les rend vulnérables aux rumeurs à propos de leur éventuel effondrement et comment la société peut réduire cette vulnérabilité. Ces intuitions fondent la régulation bancaire moderne.
A travers l’analyse statistique et des recherches à partir de sources historiques, Bernanke a démontré que l’effondrement des banques a joué un rôle décisif dans la dépression mondiale des années 1930, la pire crise dans l’histoire moderne. L’effondrement du système bancaire explique pourquoi la contraction de l’activité a été aussi profonde et aussi durable qu'elle l'a été.
Les travaux de Bernanke montrent que les crises bancaires peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Cette intuition illustre l’importance du bon fonctionnement de la régulation bancaire et fonde les décisions de politique économique prises durant la crise financière de 2008-2009. Lors de celle-ci, Bernanke était à la tête de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale, et il a pu ainsi mettre à profit ce qu’il a appris de ses travaux pour décider au mieux de la politique économique. Plus tard, quand la pandémie a éclaté en 2020, des mesures significatives ont été prises pour éviter une crise financière mondiale. Les idées des lauréats ont joué un rôle important pour assurer que ces dernières crises ne se développent pas en nouvelles dépressions avec des conséquences dévastatrices pour la société.
Des crises bancaires à l'origine de la Grande Dépression
Le principal travail pour lequel Bernanke est aujourd’hui reconnu est un article publié en 1983, dans lequel il a analysé la Grande Dépression des années 1930. Entre janvier 1930 et mars 1933, la production industrielle américaine chuta de 46 % et le chômage grimpa à 25 %. La crise se répandit comme un incendie, entraînant une forte contraction économique dans l’essentiel du monde. En Grande-Bretagne, le chômage a atteint 25 % et en Australie 29 %. En Allemagne, la production industrielle a presque été divisée par deux et plus d’un tiers de la population active s’est retrouvée sans emploi. Au Chili, le revenu national chuta de 33 % entre 1929 et 1932. Partout, des banques s’effondrèrent, des gens furent poussés à quitter leur logement et la pauvreté se généralisa également dans les pays riches. A travers le monde, les économies ne commencèrent à connaître une reprise que vers le milieu de la décennie.
Avant que Bernanke ne publie son article, la croyance conventionnelle parmi les experts était que la dépression aurait pu être empêchée si la banque centrale américaine avait imprimé plus de billets. Bernanke partagea aussi l’opinion qu’un manque de monnaie avait probablement contribué à la contraction de l’activité, mais il ne croyait pas que ce mécanisme explique pourquoi la crise fut si profonde et si longue. Bernanke montra que sa principale cause était le déclin de la capacité du système bancaire à canaliser l’épargne vers les investissements productifs. En utilisant une combinaison de sources historiques et de méthodes statistiques, son analyse montra quels facteurs étaient importants derrière la chute du produit intérieur brut (PIB). Il conclut que les facteurs qui étaient directement liés à l’effondrement des banques contribuaient à la part du lion de la contraction de l’activité.
La dépression débuta avec une récession tout à fait normale en 1929, mais en 1930 celle-ci se transforma en une crise bancaire. Le nombre de banques chuta au cours des trois années suivantes, souvent en raison de ruées bancaires. Celles-ci surviennent quand les gens qui avaient déposé de l’argent dans leur banque s’inquiètent à propos de la survie de celle-ci et se ruent aux guichets pour retirer leur épargne. Si trop de personnes se comportent ainsi simultanément, les réserves de la banque ne pourront couvrir tous les retraits et elle sera forcée de réaliser une vente d’actifs en catastrophe, avec potentiellement d’importantes pertes. Finalement, cela peut conduire la banque à la faillite.
La crainte que les ruées bancaires se multiplient entraîna une chute des dépôts dans les autres banques et beaucoup de banques devinrent frileuses à l'idée d'accorder de nouveaux prêts. Les dépôts furent placés dans des actifs qui pouvaient être rapidement vendus si les déposants désiraient soudainement retirer leur argent. Ces problèmes avec l’obtention de nouveaux prêts bancaires compliquèrent le financement des investissements pour les entreprises et détériora la situation financière des fermiers et des ménages. Il en résulta la pire récession mondiale dans l’Histoire moderne.
Avant l’étude de Bernanke, l'idée généralement admise était que la crise bancaire était une conséquence du déclin de l’économie plutôt qu’une cause de celui-ci. Bernanke montra que les effondrements bancaires jouèrent un rôle décisif dans la transformation de la récession en une dépression profonde et prolongée. Une fois que la banque fait faillite, la relation que celle-ci entretient avec son emprunteur est rompue ; cette relation contient un savoir qui s’avère nécessaire à la banque pour qu’elle gère efficacement ses prêts. La banque connaît ses emprunteurs, elle a une information détaillée à propos de la façon par laquelle ils utilisent leur argent ou des exigences nécessaires pour que le prêt soit remboursé. Construire un tel stock d’informations prend un long moment et il ne peut pas être facilement transféré à d’autres prêteurs quand une banque fait faillite. Réparer un système bancaire dysfonctionnel peut en conséquence prendre plusieurs années, une période au cours de laquelle l’économie fonctionne mal. Bernanke a démontré que l’économie n’a pas commencé à rebondir tant que l’Etat n’avait pas adopté de puissantes mesures pour empêcher que de nouvelles paniques bancaires surviennent.
Pourquoi les banques sont-elles nécessaires ?
Pour comprendre pourquoi une crise bancaire peut avoir de telles conséquences désastreuses, nous devons savoir ce que les banques font vraiment : elles reçoivent de la monnaie de personnes faisant des dépôts et elles la canalisent à leurs emprunteurs. Cette intermédiation est loin d’être un simple transfert mécanique, parce qu’il y a des conflits fondamentaux entre les besoins des épargnants et ceux des emprunteurs. Quelqu’un qui reçoit un prêt pour financer l’achat d’un logement ou d’un investissement de long terme doit être assuré que le prêteur ne va pas soudainement lui demander de rendre son argent. D’un autre côté, un épargnant désire avoir la possibilité d'utiliser une partie de son épargne dans les plus brefs délais.
La société doit résoudre ces conflits. Si les entreprises ou les ménages peuvent être forcés à rembourser leurs prêts n’importe quand, les investissements de long terme deviennent impossibles. Cela aurait des conséquences dévastatrices. L’économie ne peut fonctionner sans un système financier qui crée assez de moyens de paiement facilement accessibles et sécurisés. (...)
Le modèle de Diamond et Dybvig
Douglas Diamond et Philip Dybvig ont montré que le problème que nous venons de décrire peut être résolu par des institutions qui sont construites exactement comme les banques. Dans un article de 1983, ils développent un modèle théorique qui explique comment les banques créent de la liquidité pour les épargnants tout en permettant aux emprunteurs d’accéder à des financements de long terme. Malgré le fait que ce modèle soit relativement simple, il capture le mécanisme central de l’activité bancaire : pourquoi il fonctionne, mais aussi pourquoi le système est de façon inhérente vulnérable et nécessite d’être réglementé.
Le modèle dans cet article se fonde sur l’idée que les ménages épargnent une certaine partie de leur revenu tout en ayant le besoin d’avoir la possibilité de retirer leur monnaie quand ils le veulent. Personne ne sait en avance si et quand le besoin de monnaie surviendra, mais il ne surviendra pas au même instant pour l’ensemble des ménages. En parallèle, il y a des projets d’investissement qui nécessitent un financement. Ces projets sont profitables à long terme, mais s’ils sont terminés hâtivement, les rendements vont être très faibles.
Dans une économie sans banques, les ménages doivent faire des investissements directs dans ces projets. Les ménages qui ont besoin de monnaie rapidement vont être forcés de mettre un terme rapidement à ces projets et ils vont en conséquence avoir de très faibles rendements, avec seulement un faible montant de monnaie disponible pour leur consommation. D’un autre côté, les ménages qui n’ont pas besoin d’achever les projets aussi tôt vont jouir de bons rendements et ainsi pouvoir consommer beaucoup. Dans une telle situation, les ménages vont demander une solution qui leur permette d’accéder instantanément à leur monnaie sans que cela ne réduise significativement leurs rendements. Si une telle solution peut être mise en place, ils seront enclins à accepter des rendements à long terme légèrement plus faibles.
Dans leur article, Diamond et Dybvig expliquent comment les banques apparaissent naturellement comme intermédiaires et fournissent cette solution. La banque offre des comptes où les ménages peuvent déposer leur monnaie. Elle prête ensuite la monnaie à des projets de long terme. Les déposants peuvent retirer leur monnaie quand ils le veulent, sans perdre autant que s’ils avaient fait un investissement direct et mis un terme précocement au projet. Ces hauts rendements sont financés par des ménages qui épargnent pour un horizon plus éloigné, perdant un certain rendement à long terme relativement à ce qu’ils auraient gagné s’ils avaient fait un investissement direct dans le projet.
Les banques créent de la monnaie
Diamond et Dybvig montrent que ce processus est celui par lequel les banques créent de la liquidité. La monnaie sur les comptes des déposants est un passif pour la banque, tandis que les actifs de la banque comprennent des prêts à des projets de long terme. Les actifs de la banque ont une longue maturité, parce qu’elle promet aux emprunteurs qu’ils n’auront pas à rembourser rapidement leurs prêts. D’un autre côté, les passifs de la banque ont une courte maturité : les déposants peuvent accéder à leur monnaie quand ils le veulent. La banque est un intermédiaire qui transforme des actifs avec une longue maturité en des comptes bancaires avec une courte maturité. C’est ce que l’on appelle la transformation de maturité.
Les épargnants peuvent utiliser leurs comptes de dépôt pour des paiements directs. La banque a donc créé de la monnaie à partir, non pas de rien, mais des projets de long terme auxquels elle a prêté de la monnaie. Les banques sont parfois critiquées pour leur création de monnaie, mais c’est précisément pour cela qu’elles existent.
Vulnérables aux rumeurs
Il est facile de voir que la transformation de maturité est utile pour la société, mais les lauréats démontrent aussi que le modèle d’affaires des banques est vulnérable. Une rumeur peut se répandre en suggérant que davantage d’épargnants désirent retirer leur monnaie, mais que la banque ne peut satisfaire toute la demande. Qu’elle soit fondée ou non, cette rumeur peut inciter les déposants à se ruer à leur banque pour retirer leur monnaie dans la crainte que celle-ci ne fasse faillite. Une ruée bancaire s’ensuit. Pour payer tous ses déposants, la banque est forcée de faire rembourser en avance ses prêts en cours, ce qui amène les projets d’investissement à long terme à être terminés précocement et entraîne des ventes d’actifs en catastrophe. Les pertes qui en résultent peuvent amener la banque à faire faillite. Le mécanisme que Bernanke a montré comme étant l’amorce de la dépression des années 1930 est donc une conséquence directe de la vulnérabilité inhérente des banques.
Diamond et Dybvig présentent aussi une solution au problème de la vulnérabilité des banques, sous la forme d’une assurance-dépôt par le gouvernement. Quand les déposants savent que l’Etat a garanti leur monnaie, ils n’ont plus besoin de se ruer à la banque dès qu’une rumeur de détresse bancaire se propage. Cela stoppe une ruée bancaire avant même qu’elle ne débute. L’existence d’une assurance-dépôt fait qu’elle n’a en théorie jamais à être utilisée. Cela explique pourquoi la plupart des pays ont maintenant adopté un tel dispositif. (…)
Au fondement de la réglementation bancaire moderne
Les travaux pour lesquels Bernanke, Dybvig et Diamond ont été récompensés ont été cruciaux pour la recherche ultérieur qui a amélioré notre compréhension des banques, de la réglementation bancaire, des crises bancaires et de la façon par laquelle ces dernières doivent être gérée. Les intuitions théoriques de Diamond et Dybvig à propos de l’importance des banques et de leur inhérente vulnérabilité fournissent les fondations pour la réglementation bancaire moderne, qui vise à créer un système financier stable. Avec les analyses des crises financières réalisées par Bernanke, nous comprenons mieux pourquoi la réglementation échoue parfois, l’énorme ampleur des conséquences et ce que les pays peuvent faire pour stopper une crise bancaire lorsqu’elle éclate, comme au début de la récente pandémie.
De nouveaux intermédiaires financiers qui, comme les banques, gagnent de la monnaie de la transformation de maturité ont émergé en-dehors du secteur bancaire réglementé au début des années 2000. Des ruées touchant ce système bancaire parallèle (shadow banks) ont joué un rôle clé dans la crise financière de 2008-2009. Les théories de Diamond et Dybvig fonctionnent également bien pour analyser de tels événements même si, en pratique, la réglementation ne peut pas toujours suivre la nature changeante du système financier.
La recherche ne peut pas fournir des réponses définitives sur la façon de réglementer le système financier. L’assurance-dépôt ne fonctionne pas toujours comme on s’y attend : elle peut inciter les banques à s’engager dans une spéculation risquée dont les contribuables ont à payer la facture quand elle tourne mal. La nécessité de sauver le système bancaire durant les crises peut aussi entraîner des profits inacceptables pour les propriétaires et salariés des banques. D’autres types de règles à propos du capital bancaire et des règles qui limitent le montant d’emprunt dans l’économie peuvent donc s’avérer nécessaires. Les avantages et inconvénients de telles règles doivent être analysés et la façon par laquelle elles fonctionnent peut changer au cours du temps.
Comment réglementer les marchés financiers pour qu’ils assurent correctement leur fonction (canaliser l’épargne vers les investissements productifs sans provoquer régulièrement des crises) est une question à laquelle planchent encore les chercheurs et les politiciens. Les travaux qui ont été récompensés cette année et ceux qui se sont appuyés sur eux ont permis à ce que la société soit mieux équipée pour répondre à ce défi. Ils réduisent le risque que les crises financières se développent en longues dépressions avec de sévères répercussions sur la société, ce qui est d’un grand bénéfique pour nous tous. »
L'Académie royale des sciences de Suède, « The laureates explained the central role of banks in financial crises. Popular science background », 10 octobre 2022. Traduit par Martin Anota
aller plus loin...
« Les contributions de Bernanke à la science économique »
« Les répercussions réelles des ruées bancaires »
« Les modèles ne saisissent toujours pas ce qu’est une banque »