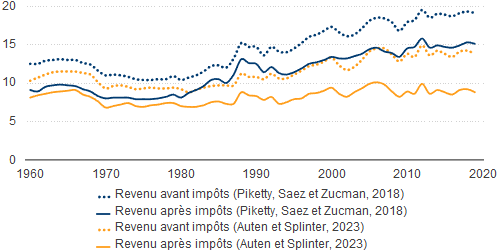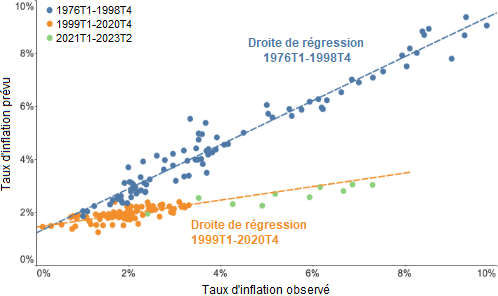« Nous avons beaucoup entendu parler du fait que les performances de l’économie américaine sous la présidence de Joe Biden ont été bien meilleures que ne le pensent les électeurs. Mais l’épisode actuel n’est qu’un exemple d’une plus grande énigme : depuis la Seconde Guerre mondiale, les performances de l’économie américaine ont été constamment meilleures sous les présidences démocrates que sous les présidences républicaines. Ce fait est encore moins connu, y compris parmi les électeurs démocrates, que la vérité à propos du mandat de Biden. En effet, certains sondages suggèrent que davantage d’Américains pensent le contraire, à savoir que les présidents républicains savent mieux gérer l’économie que les démocrates.
Dans un sens, il n’est pas vraiment surprenant que si peu de gens sachent que les performances économiques ont toujours été meilleures sous un parti que sous l’autre. La proposition semble improbable à première vue, comme le genre d’affirmation ouvertement partisane qui ne vaut même pas la peine d’être vérifiée. L’énigme est le fait lui-même : il est complètement exact.
Les statistiques pertinentes ont déjà été compilées, mais mettons-les à jour.
Croyez-le ou non
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les créations d'emplois ont été en moyenne de 1,7 % par an lorsque les démocrates étaient au pouvoir, contre 1,0 % sous présidence républicaine. Le PIB américain a connu un taux de croissance moyen de 4,23 % par an sous les présidences démocrates, contre 2,36 % sous les présidences républicaines, soit une différence remarquable de 1,87 points de pourcentage. Il s’agit de données d’après-guerre, couvrant 19 mandats présidentiels, de Truman à Biden. Si l’on remonte plus loin, jusqu’à la Grande Dépression, pour inclure Herbert Hoover et Franklin Roosevelt, la différence entre les taux de croissance est encore plus grande.
Les résultats sont similaires, qu’importe si on attribue ou non la responsabilité du premier trimestre du mandat d’un président à ce dernier ou à son prédécesseur. De même, les mandats présidentiels démocrates ont a été en moyenne en récession pendant 1 trimestre sur 16 trimestres, alors que les mandats républicains ont été en récession pendant 5 trimestres sur 16, soit une différence étonnamment grande.
Il y a des raisons d'être sceptique
Même ceux d’entre nous qui croient que les démocrates ont peut-être mené de meilleures politiques que les républicains, dans l’ensemble, ont du mal à expliquer l’important écart de performances que l’on observe. Après tout, de nombreux autres facteurs puissants et imprévisibles influencent l’économie, éclipsant souvent l’effet des leviers que le président peut contrôler.
En outre, de nombreuses politiques, bonnes ou mauvaises, ne produisent leurs principaux effets que sur une période plus longue qu’un cycle présidentiel. Par exemple, Jimmy Carter mérite de recevoir le crédit pour avoir nommé Paul Volcker à la présidence de la Fed en 1979 avec pour mandat de vaincre l’inflation à tout prix. La désinflation qui a suivi a été couronnée de succès, contribuant à préparer le terrain pour la Grande Modération des vingt années suivantes. Mais son impact immédiat en 1980 fut une récession. La plupart des économistes considèrent que la contraction monétaire de Volcker en valait le prix. Mais la récession a contribué à l'échec de Carter à être réélu en novembre de la même année. Ironiquement, c’est la seule et unique récession des soixante-dix dernières années à avoir eu lieu avec un démocrate à la Maison Blanche.
Est-ce juste le fruit du hasard ?
Alors, ces différences de performances sont-elles simplement le résultat du hasard ? On pourrait le penser. Mais l’application d’une méthodologie statistique universellement acceptée dit le contraire.
Les cinq dernières récessions ont toutes commencé alors qu’un républicain était à la Maison Blanche (Reagan, H.W. Bush, W. Bush, deux fois, et Trump). Les lecteurs peuvent consulter la chronologie par eux-mêmes. Les chances d'obtenir ce résultat par hasard, si la véritable probabilité qu'une récession démarre était la même pour un mandat démocrate que pour un mandat républicain, seraient (1/2)(1/2)(1/2)(1/ 2)(1/2), soit 1 sur 32 = 3,1 %. C’est très improbable. C’est la même probabilité que celle d’obtenir "face" sur cinq tirages au sort consécutifs sur cinq. Un tel rejet de l’égalité est considéré comme "statistiquement significatif au niveau de confiance de 95 %".
Et si l’on remontait plus loin ? Il est remarquable que 9 des 10 dernières récessions aient commencé alors qu’un républicain était président. Les chances que ce résultat se produise par hasard sont encore plus faibles : une sur 100. (Plus exactement 10 sur 210 = 0,0098.)
Blinder et Watson (2016) ont souligné un autre fait remarquable. Ils ont observé les huit fois depuis la Seconde Guerre mondiale où un président sortant d'un parti avait cédé la Maison Blanche à un dirigeant de l'autre parti. Nous avons eu deux présidents supplémentaires depuis. Mettons à jour leurs constats, en ajoutant les mandats de Trump et Biden (jusqu'à présent). Durant cinq des dix dernières transitions, un démocrate a été remplacé par un républicain ; à chaque fois, le taux de croissance a diminué d'un mandat à l'autre. Dans cinq des transitions, un républicain a été remplacé par un démocrate ; à chaque fois, le taux de croissance a augmenté. Aucune exception. Dix sur dix. Quelles sont les chances que cela se produise par hasard ? La probabilité est la même que la probabilité d’obtenir face sur 10 lancers de pièces consécutifs : ½ fois multiplié 10 fois, soit 1 sur 1.024. En d’autres termes, la différence est statistiquement significative au niveau de 99,9 %.
On peut donc rejeter en toute sécurité l’affirmation selon laquelle les performances économiques seraient meilleures avec les présidents républicains. Mais qu’est-ce qui explique le bilan étonnamment meilleur que l’on enregistre pour les présidences démocrates ? Cela reste une énigme. »
Jeffrey Frankel, « The historical puzzle of US economic performance under Democrats vs. Republicans », in Econbrowser (blog), mars 2024. Traduit par Martin Anota
« La croissance américaine est la plus forte sous présidence démocrate »
« Peut-on féliciter Trump pour la bonne santé de l’économie américaine ? »
« Quelle est la contribution d’un chef d’Etat à la croissance économique ? »